 Je viens de relire la préface de Pierre Bourdieu à La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré d’Abdelmalek Sayad (1), juste après avoir lu l’article Immigration – Les espoirs déçus de nos cousins français dans le journal La Presse d’aujourd’hui.
Je viens de relire la préface de Pierre Bourdieu à La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré d’Abdelmalek Sayad (1), juste après avoir lu l’article Immigration – Les espoirs déçus de nos cousins français dans le journal La Presse d’aujourd’hui.
À une époque où la mondialisation n’a jamais été aussi forte et ce, dans tous les domaines, l’intolérance et la violence à leur paroxysme, les guerres et les menaces de guerre omniprésentes, force nous est de constater (si ce n’est déjà fait) que rien ne changera si nous n’acceptons pas notre responsabilité individuelle.
Dans sa préface à La double absence, Pierre Bourdieu nous parle de «… [la] solidarité avec les plus démunis [d’Abdelmalek Sayad] principe d'une formidable lucidité épistémologique, [qui] lui permettait de démonter ou de détruire en passant, sans avoir l'air d'y toucher, nombre de discours et de représentations communs ou savants concernant les immigrés ».


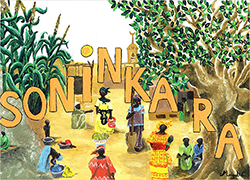

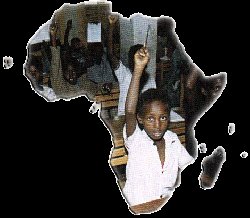
 En France, ces dernières décennies, les ressortissants subsahariens et notamment les Maliens, sont devenus l’une des figures emblématiques de « l’immigré », dans toutes ses variantes : travailleur non-qualifié, résident de foyer, clandestin... A cette imagerie traditionnelle, si l’on ose dire, attachée à toutes les migrations du passé, sont venus s’agréger quelques traits supplémentaires attribués en propre aux Subsahariens : la polygamie, l’excision, autant de caractéristiques culturelles qu’ils étaient tous plus ou moins censés partager et qui ne pouvaient que freiner, pour ne pas dire empêcher, leur intégration.
En France, ces dernières décennies, les ressortissants subsahariens et notamment les Maliens, sont devenus l’une des figures emblématiques de « l’immigré », dans toutes ses variantes : travailleur non-qualifié, résident de foyer, clandestin... A cette imagerie traditionnelle, si l’on ose dire, attachée à toutes les migrations du passé, sont venus s’agréger quelques traits supplémentaires attribués en propre aux Subsahariens : la polygamie, l’excision, autant de caractéristiques culturelles qu’ils étaient tous plus ou moins censés partager et qui ne pouvaient que freiner, pour ne pas dire empêcher, leur intégration. Témoignages sur les immigrés, les expulsés, les zones de refoulement. Inactions et complicité des Etats africains. Quels sont les recours juridiques, les réflexions et actions à mener ?
Témoignages sur les immigrés, les expulsés, les zones de refoulement. Inactions et complicité des Etats africains. Quels sont les recours juridiques, les réflexions et actions à mener ?