
Il est largement admis que les conditions économiques sont un déterminant essentiel les migrations. Selon les modèles économiques d’inspiration néo-classique, la rationalité migratoire s’inscrit ainsi dans le déséquilibre entre les conditions défavorables des milieux de départ et celles plus attractives, des lieux de destination.
L’EXODE RURAL FRUIT DE L’ECART DU DEVELOPPEMENT
Dans le contexte du développement urbain des pays africains, les zones rurales pauvres, excédentaires en main d’oeuvre, envoient le surplus dans les zones urbaines. Qui sont en pleine croissance économique et demandeuses de main d’oeuvre.
En dépit de la récession urbaine, la crise économique et les contraintes liées à la dégradation de l’environnement entre autres la sécheresse, irrégularité des pluies, accroissement démographique et les ressources naturelles limitées ont contribué à entretenir les mouvements migratoires et à inscrire le recours à la pratique migratoire dans les stratégies de diversification des revenus développées par les femmes pour faire face à la détérioration des conditions économiques en milieu rural.


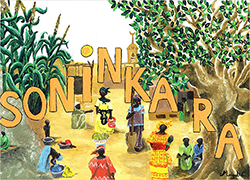
 Aujourd’hui, dans les foyers d’Africains noirs, une interrogation nouvelle : comment tiliser, gérer au mieux le séjour en France pour le village, voire le pays ? Ce texte s’attache à retracer le parcours, le va et vient du foyer au village, de l’usine aux champs. Ce chemin , nous l'avons nous-mêmes emprunté aux côtés des intéressés : des discussions liminaires aux projets de développement dans les foyers, jusqu’aux réalisations dans les villages.
Aujourd’hui, dans les foyers d’Africains noirs, une interrogation nouvelle : comment tiliser, gérer au mieux le séjour en France pour le village, voire le pays ? Ce texte s’attache à retracer le parcours, le va et vient du foyer au village, de l’usine aux champs. Ce chemin , nous l'avons nous-mêmes emprunté aux côtés des intéressés : des discussions liminaires aux projets de développement dans les foyers, jusqu’aux réalisations dans les villages.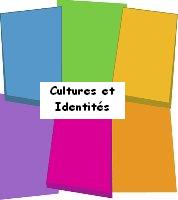 Les mouvements associatifs respectivement impulsés par des migrants et des migrantes africains en France font preuve d'un dynamisme exceptionnel et durable. Ce texte analyse comment joue, de manière différenciée selon les appartenances de sexes, la référence à un ou plusieurs territoires dans les processus identitaires à l'oeuvre en situation migratoire. Les hommes et les femmes, originaires de la vallée du fleuve Sénégal, créent des associations dont les objectifs sont à la fois contradictoires et complémentaires. Pour les hommes, il s'agit de redéfinir les cadres d'une citoyenneté qui s'actualise sur un espace recomposée : la France et le Mali, de participer aux transformations économiques et politiques en cours dans leur région d'origine, en valorisant au mieux leur mobilité. Les préoccupations des femmes manifestent, quant à elles, une volonté de conquérir le nouvel espace local urbain, espace de résidence. Ce faisant, elles construisent conjointement les bases nécessaires à un changement de statut auquel elles aspirent dans la nouvelle situation et celles qui permettent l'organisation d'une diaspora africaine en France. Cette diaspora autorise un "nomadisme contrarié" et en prescrit les formes.
Les mouvements associatifs respectivement impulsés par des migrants et des migrantes africains en France font preuve d'un dynamisme exceptionnel et durable. Ce texte analyse comment joue, de manière différenciée selon les appartenances de sexes, la référence à un ou plusieurs territoires dans les processus identitaires à l'oeuvre en situation migratoire. Les hommes et les femmes, originaires de la vallée du fleuve Sénégal, créent des associations dont les objectifs sont à la fois contradictoires et complémentaires. Pour les hommes, il s'agit de redéfinir les cadres d'une citoyenneté qui s'actualise sur un espace recomposée : la France et le Mali, de participer aux transformations économiques et politiques en cours dans leur région d'origine, en valorisant au mieux leur mobilité. Les préoccupations des femmes manifestent, quant à elles, une volonté de conquérir le nouvel espace local urbain, espace de résidence. Ce faisant, elles construisent conjointement les bases nécessaires à un changement de statut auquel elles aspirent dans la nouvelle situation et celles qui permettent l'organisation d'une diaspora africaine en France. Cette diaspora autorise un "nomadisme contrarié" et en prescrit les formes. Les migrations qui de tout temps ont été le fait es populations de la vallée du Sénégal sont-elles la réponse à un surpeuplement relatif, compte tenu des conditions naturelles, des techniques de production et des Systèmes agro-pastoraux de cette région ?
Les migrations qui de tout temps ont été le fait es populations de la vallée du Sénégal sont-elles la réponse à un surpeuplement relatif, compte tenu des conditions naturelles, des techniques de production et des Systèmes agro-pastoraux de cette région ? La migration des ressortissants de la Vallée du Fleuve Sénégal a suscité l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, décrivent l'ampleur démographique et historique de ce phénomène. Il était intéressant un peu plus de dix ans après l'enquête réalisée en 1982 par l'OCDE et le CILSS et présentée par Condé et Diagne (1986), d'observer les conséquences des migrations sur les structures démographiques des populations des zones d'origine. L'analyse des structures familiales permettra en outre d'appréhender la fréquence des divisions ou des regroupements familiaux dans un milieu fortement migrant.
La migration des ressortissants de la Vallée du Fleuve Sénégal a suscité l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, décrivent l'ampleur démographique et historique de ce phénomène. Il était intéressant un peu plus de dix ans après l'enquête réalisée en 1982 par l'OCDE et le CILSS et présentée par Condé et Diagne (1986), d'observer les conséquences des migrations sur les structures démographiques des populations des zones d'origine. L'analyse des structures familiales permettra en outre d'appréhender la fréquence des divisions ou des regroupements familiaux dans un milieu fortement migrant.