 La communauté soninké, comme la plupart des communautés ouest africaines au sud et au nord du Sahara, a connu l'islamisation par les biais des Almoravides qui, quelques décennies après la mort du prophète Muhammad (SAW), ont sillonné presque toute l’Afrique et une grande partie du monde pour propager le message de l'islam.
La communauté soninké, comme la plupart des communautés ouest africaines au sud et au nord du Sahara, a connu l'islamisation par les biais des Almoravides qui, quelques décennies après la mort du prophète Muhammad (SAW), ont sillonné presque toute l’Afrique et une grande partie du monde pour propager le message de l'islam.
Avant l’avènement de la religion islamique en milieu soninké, les Soninké étaient de très grands adorateurs d’idoles. L’histoire de l’empire du Ghana, avec sa tradition mythique de wagadou-bida (le serpent), est une illustration plus ou moins parfaite de l’attachement des Soninké aux histoires surnaturelles qui sont contraires au monothéisme. Après l’éclatement de ce grand empire soninké au XII ou XIII siècle, les Soninké se sont dispersés à travers différents pays ou royaumes de la sous région. Cet éclatement de l’empire soninké de Wagadu a été interprété différemment. Pour la tradition, c’est la mort du serpent-bida, qui était alors considéré comme le protecteur de la communauté soninké, qui est la cause principale de la chute de l’empire, tandis que pour les historiens c’est à cause des attaques répétitives des Almoravides et de Sundjata Keita, empereur du Mali, qui auraient inévitablement provoqué la perte des Soninké. Dans tous les cas de figure, nos Soninké étaient obligés de quitter leur empire, et en partant ils ont emporté avec eux d’anciennes traditions qui, même après l’implantation de l’islam en milieu soninké, continuent de rythmer le quotidien de la population. Dans cette réflexion, nous allons sommairement tenter de rappeler les principes fondamentaux du monothéisme islamique tout en montrant, d’une manière non exhaustive, la manière dont les fidèles soninké de l’islam s’en éloignent pour des raisons que nous allons brièvement évoquer ici.


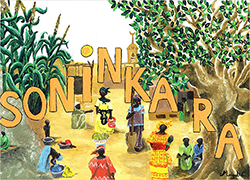
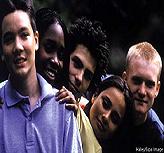 La construction de l'identité chez les adolescents issus de l'immigration africaine.
La construction de l'identité chez les adolescents issus de l'immigration africaine.  L'histoire de l'immigration aujourd'hui. Quelques pistes de réflexion
L'histoire de l'immigration aujourd'hui. Quelques pistes de réflexion  Le foyer Bara, un village pour les Maliens de Montreuil.
Le foyer Bara, un village pour les Maliens de Montreuil. La population de Toulel, comme d’ailleurs tous les peuples ouest africains, sont des grands voyageurs. Au début du siècle dernier, les jeunes gens en quête d’une meilleure condition de vie matérielle partaient chercher fortune dans les pays de la sous région comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Gambie…Cette migration vers les pays les plus proches du pays d’émigration se faisait principalement en deux temps : en période d’hivernage, les travailleurs saisonniers ou navétanes partaient cultiver les champs d’arachides dans les bassins arachidiers au Sénégal ou en Gambie. Ils y restaient jusqu’à la fin des récoltes.
La population de Toulel, comme d’ailleurs tous les peuples ouest africains, sont des grands voyageurs. Au début du siècle dernier, les jeunes gens en quête d’une meilleure condition de vie matérielle partaient chercher fortune dans les pays de la sous région comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Gambie…Cette migration vers les pays les plus proches du pays d’émigration se faisait principalement en deux temps : en période d’hivernage, les travailleurs saisonniers ou navétanes partaient cultiver les champs d’arachides dans les bassins arachidiers au Sénégal ou en Gambie. Ils y restaient jusqu’à la fin des récoltes.