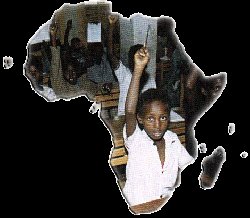
Lorsqu'on soulève le débat sur l’immigration, beaucoup de gens ont tendance à se focaliser sur les avantages socioéconomiques de ce fléau qui est séculaire dans un pays comme le Mali. Depuis la nuit des temps, le Malien est un grand voyageur devant l’Eternel. Et on ne peut pas nier aujourd’hui que les immigrés jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie de leurs familles et de leurs localités.
A une date récente, près de 90 % des immigrés maliens en France étaient des Soninkés originaires de la région de Kayes. Une région qui vit essentiellement grâce à l’argent envoyé de France par la diaspora et les aides des projets de développement. Environ 4,6 milliards de F CFA (7 millions d’euros) ont ainsi été transférés en 2002 vers la ville de Kayes, qui, avec six agences bancaires, est aujourd’hui la deuxième place financière du Mali, après Bamako.


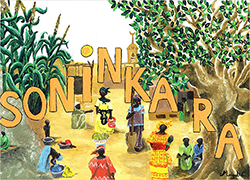
 En France, ces dernières décennies, les ressortissants subsahariens et notamment les Maliens, sont devenus l’une des figures emblématiques de « l’immigré », dans toutes ses variantes : travailleur non-qualifié, résident de foyer, clandestin... A cette imagerie traditionnelle, si l’on ose dire, attachée à toutes les migrations du passé, sont venus s’agréger quelques traits supplémentaires attribués en propre aux Subsahariens : la polygamie, l’excision, autant de caractéristiques culturelles qu’ils étaient tous plus ou moins censés partager et qui ne pouvaient que freiner, pour ne pas dire empêcher, leur intégration.
En France, ces dernières décennies, les ressortissants subsahariens et notamment les Maliens, sont devenus l’une des figures emblématiques de « l’immigré », dans toutes ses variantes : travailleur non-qualifié, résident de foyer, clandestin... A cette imagerie traditionnelle, si l’on ose dire, attachée à toutes les migrations du passé, sont venus s’agréger quelques traits supplémentaires attribués en propre aux Subsahariens : la polygamie, l’excision, autant de caractéristiques culturelles qu’ils étaient tous plus ou moins censés partager et qui ne pouvaient que freiner, pour ne pas dire empêcher, leur intégration. Témoignages sur les immigrés, les expulsés, les zones de refoulement. Inactions et complicité des Etats africains. Quels sont les recours juridiques, les réflexions et actions à mener ?
Témoignages sur les immigrés, les expulsés, les zones de refoulement. Inactions et complicité des Etats africains. Quels sont les recours juridiques, les réflexions et actions à mener ? Emigration - Enjeux et perspectives : Une question sécuritaire pour eux, un enjeu de développement pour nous !
Emigration - Enjeux et perspectives : Une question sécuritaire pour eux, un enjeu de développement pour nous !