La mort est l'occasion pour le clan affecté de compter ses amis, ses alliés et aussi ses adversaires. Elle est, par les lamentations des pleureuses, l'occasion de magnifier la vie du défunt. En pays soninké, on ne meurt pas anonymement.
À l'agonie, le mourant est couché sur son côté droit, la tête tournée vers le sud et le visage vers l'Est. Une fois qu'il a rendu l’âme, les femmes de la concession commencent des lamentations suffisamment fort pour se faire entendre. En des temps où la valeur guerrière était une référence sociale, plusieurs coups de fusil étaient tirés.


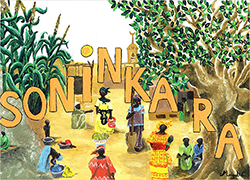
 Chez les Soninké, on n'épouse pas forcément la femme qu'on aime mais celle qu'on doit épouser. Celle-ci appartient nécessairement au même rang social même. Si pour des raisons de jonnu notamment on peut appartenir à une même classe sans être pour autant autorisé à se marier. Quand un jeune homme a l'intention d'épouser une fille, il s'en ouvre d'abord à son père et à sa mère. Généralement les parents vont consulter le marabout afin de savoir si le projet est de bon ou de mauvais augure. Il peut ordonner des sacrifices à faire pour obtenir la faveur de Dieu ou des esprits. C'est une fois passé ce cap strictement familial et souvent confidentiel que la demande en mariage est présentée à la famille de la fille.
Chez les Soninké, on n'épouse pas forcément la femme qu'on aime mais celle qu'on doit épouser. Celle-ci appartient nécessairement au même rang social même. Si pour des raisons de jonnu notamment on peut appartenir à une même classe sans être pour autant autorisé à se marier. Quand un jeune homme a l'intention d'épouser une fille, il s'en ouvre d'abord à son père et à sa mère. Généralement les parents vont consulter le marabout afin de savoir si le projet est de bon ou de mauvais augure. Il peut ordonner des sacrifices à faire pour obtenir la faveur de Dieu ou des esprits. C'est une fois passé ce cap strictement familial et souvent confidentiel que la demande en mariage est présentée à la famille de la fille. " ... C’est pour avoir mangé une fois dans un village près de Bakel – une seule fois au cours de mes nombreux séjours – un plat de semoule de mil cuite avec sa sauce que je me suis intéressée au sanglé des sources écrites. Bien que les témoignages anciens sur cette région n’y fassent pas référence, on peut comparer le sanglé avec les plats soninkés à base de semoule, nyecce, ou d’un mélange de farine et de semoule fine, jura et fanso... "
" ... C’est pour avoir mangé une fois dans un village près de Bakel – une seule fois au cours de mes nombreux séjours – un plat de semoule de mil cuite avec sa sauce que je me suis intéressée au sanglé des sources écrites. Bien que les témoignages anciens sur cette région n’y fassent pas référence, on peut comparer le sanglé avec les plats soninkés à base de semoule, nyecce, ou d’un mélange de farine et de semoule fine, jura et fanso... "