 "Des « réfugiés-migrants » : Les parcours d’exil des réfugiés mauritaniens au Sénégal"
"Des « réfugiés-migrants » : Les parcours d’exil des réfugiés mauritaniens au Sénégal"
Ce texte a servi de support à une communication présentée pour le colloque international sur l’« Asile au Sud », organisé par le CEPED, l’IRD, le Centre d’Etudes Africaines et l’Université de Ougadougou, 6-8 Juin 2006. La participation à été possible grâce au Programme ASILES (dir. M. Agier).
L’image la plus répandue du camp de réfugié est celle d’un espace fermé et isolé dans lequel des milliers de personnes survivent grâce à l’assistance humanitaire. Cette image ne reflète pourtant pas la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, étroitement contrôlés par les autorités du pays d’accueil ou non, les sites de réfugiés ne sont en réalité jamais complètement clos. Le déplacement forcé et le regroupement dans des camps suscitent sans cesse de nouvelles formes de mobilités, qui sont activement recherchées par les individus pour reconstruire un capital économique, social et politique. Lorsque la liberté de circulation des réfugiés est restreinte par les pays d’asile, ces mobilités ne disparaissent pas pour autant. Elles deviennent simplement clandestines et donc invisibles aux yeux de l’observateur non averti. Même des camps tels que Dadaab au Kenya ou Kigoma en Tanzanie, réputés pour leur isolement, se trouvent en réalité au cœur de chaînes migratoires et de transferts financiers considérables (S.Turner, 2002 ; Horst, 2002).


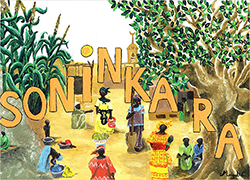
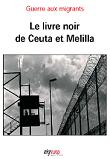
 Alors que se tarit l'aide du Nord, les émigrés transfèrent vers leurs familles des fonds chaque année plus importants: cette manne financière couvre les besoins quotidiens, mais contribue aussi au développement de régions déshéritées. Enquête dans un village sénégalais : Waoundé
Alors que se tarit l'aide du Nord, les émigrés transfèrent vers leurs familles des fonds chaque année plus importants: cette manne financière couvre les besoins quotidiens, mais contribue aussi au développement de régions déshéritées. Enquête dans un village sénégalais : Waoundé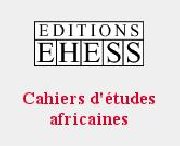
 Des maliens de France vivent aujourd'hui, un véritable calvaire. En plus de la persécution policière contre les sans-papiers, ils ont de la peine à trouver un logement décent. Au Foyer AFTAM BARA situé dans la commune de Montreuil et qui est considéré comme le plus grand foyer de Paris, certains de nos compatriotes de la diaspora vivent dans la promiscuité la plus totale. Dans ce grand foyer, il y a une surpopulation qui frise la révolte. En effet, crée le 27 mars 1968 pour accueillir 205 travailleurs saisonniers qui faisaient la ronde entre la France et l'Afrique, le Foyer AFTAM BARA de Montreuil accueille aujourd'hui plus de 500 personnes.
Des maliens de France vivent aujourd'hui, un véritable calvaire. En plus de la persécution policière contre les sans-papiers, ils ont de la peine à trouver un logement décent. Au Foyer AFTAM BARA situé dans la commune de Montreuil et qui est considéré comme le plus grand foyer de Paris, certains de nos compatriotes de la diaspora vivent dans la promiscuité la plus totale. Dans ce grand foyer, il y a une surpopulation qui frise la révolte. En effet, crée le 27 mars 1968 pour accueillir 205 travailleurs saisonniers qui faisaient la ronde entre la France et l'Afrique, le Foyer AFTAM BARA de Montreuil accueille aujourd'hui plus de 500 personnes.