Le chantier des mutations des foyers de travailleurs migrants en résidences sociales est un défi aux enjeux colossaux : humains, sociaux, politiques, techniques... Les gestionnaires regroupés au sein de l'UNAFO et l'Etat se mobilisent pour y faire face
Nous assistons aujourd'hui à la fin d'un cycle : celui des foyers de travailleurs migrants et l'émergence d'un nouveau cycle : celui des résidences sociales (1). Au delà du changement de nom ou de la volonté politique affichée par l'Etat, nous avons bien à faire face à une réalité incontournable. Les résidents ont vieilli, tout comme les foyers qu'ils occupent, et les gestionnaires avec l'ensemble de leurs partenaires doivent faire face aux mutations actuelles !
Celles-ci concernent à la fois l'accueil de nouvelles populations précarisées, l'adaptation du bâti et des projets sociaux des foyers et résidences sociales aux nouveaux besoins des résidents, à des usages différents et leur inscription nécessaire dans la ville et les politiques urbaines. Il y a là un enjeu essentiel qui, au-delà des populations immigrées vieillissantes, concerne toutes les personnes en situation de précarité à la recherche d'un habitat transitoire ou de lieux de vie adaptés à leur situation personnelle. Ces mutations, ces enjeux, les gestionnaires de foyers de travailleurs migrants et résidences sociales ont décidé d'y faire face en se donnant à eux-mêmes par l'intermédiaire de l'UNAFO les moyens d'accomplir les transformations devenues nécessaires.


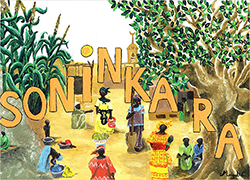
 L'explosion depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant du nombre de travaux historiques portant sur les femmes ou « le genre » n'a touché que tardivement le continent africain. Les chercheurs anglophones ont amorcé cependant un mouvement qui ne cesse de susciter de nouvelles recherches. Cette réflexion, à la croisée de l'histoire des missionnaires, de l'histoire des femmes et de l'histoire coloniale, a profondément renouvelé les connaissances et la compréhension de la place des femmes dans des sociétés à la fois patriarcales et coloniales. Curieusement, étant donné la façon dont l'éducation structure les sociétés et les mentalités, l'éducation des filles en Afrique noire est un sujet qui n'est développé que depuis peu dans l'historiographie de la période contemporaine, la plupart du temps dans une forme encore inédite. Les sociétés missionnaires et les congrégations religieuses s'intéressent pourtant de manière précoce au sexe féminin. Les femmes « invisibles », soeurs ou épouses de missionnaires protestants, offrent souvent aux filles ou femmes africaines évangélisation, éducation, et soins de santé.
L'explosion depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant du nombre de travaux historiques portant sur les femmes ou « le genre » n'a touché que tardivement le continent africain. Les chercheurs anglophones ont amorcé cependant un mouvement qui ne cesse de susciter de nouvelles recherches. Cette réflexion, à la croisée de l'histoire des missionnaires, de l'histoire des femmes et de l'histoire coloniale, a profondément renouvelé les connaissances et la compréhension de la place des femmes dans des sociétés à la fois patriarcales et coloniales. Curieusement, étant donné la façon dont l'éducation structure les sociétés et les mentalités, l'éducation des filles en Afrique noire est un sujet qui n'est développé que depuis peu dans l'historiographie de la période contemporaine, la plupart du temps dans une forme encore inédite. Les sociétés missionnaires et les congrégations religieuses s'intéressent pourtant de manière précoce au sexe féminin. Les femmes « invisibles », soeurs ou épouses de missionnaires protestants, offrent souvent aux filles ou femmes africaines évangélisation, éducation, et soins de santé. 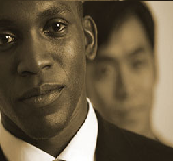 STRATÉGIES MIGRATOIRES ET PERSPECTIVES GOUVERNEMENTALES
STRATÉGIES MIGRATOIRES ET PERSPECTIVES GOUVERNEMENTALES Les difficultés liées au regroupement familial en France (divorces, insubordination des enfants), le développement des migrations inter - africaines (notamment des femmes), ont poussé les migrants à chercher des solutions pour sauvegarder les villages. Ainsi voit-on émerger des stratégies consistant à choisir parmi les enfants ceux qui, nés en France mais élevés dans la cellule traditionnelle, et ayant eu accès à un bon niveau d'éducation, pourront perpétuer le système migratoire tout en permettant le retour au pays de la génération précédente.
Les difficultés liées au regroupement familial en France (divorces, insubordination des enfants), le développement des migrations inter - africaines (notamment des femmes), ont poussé les migrants à chercher des solutions pour sauvegarder les villages. Ainsi voit-on émerger des stratégies consistant à choisir parmi les enfants ceux qui, nés en France mais élevés dans la cellule traditionnelle, et ayant eu accès à un bon niveau d'éducation, pourront perpétuer le système migratoire tout en permettant le retour au pays de la génération précédente.