Les jeunes filles d’origine africaine en france : Parcours scolaires, accès au travail et destin social.
La présente synthèse rend compte des résultats d’une étude menée en 1996 et 1997, qui avait pour objectif de “saisir la manière dont s’articulent pour les jeunes filles d’origine africaine subsaharienne les impératifs de la société globale à ceux des sociétés dont leurs parents sont originaires.“
L’enquête de terrain effectuée en région parisienne a consisté à “construire une situation de dialogue intime“ avec vingt-cinq jeunes filles âgées de seize et vingt-huit ans, c’est à dire appartenant en principe à la “deuxième génération“ dite immigrée, en majorité (20 d’entre elles) de confession musulmane.
En optant pour une approche anthropologique, l’étude s’est attachée à mettre en relief sur le mode de l’interprétation de récits de vie :
- la diversité des structures familiales auxquelles appartiennent ces jeunes filles ; les représentations et les pratiques des parents vis-à-vis de leurs enfants (religion, scolarisation ; sexualité ; mariage ; etc…) ;
- la diversité des rapports des jeunes filles à leur habitat, aux modalités de leur
socialisation et aux formes de citoyenneté auxquelles elles sont appelées à participer ;
- les parcours scolaires et l’accès à l’emploi.
Effectuée pour la Direction de la Population et des Migrations (DPM), cette étude a été réalisée par Catherine Quiminal, anthropologue (Université Paris VII), Hamédy Diarra (Association pour la promotion de la langue et de la culture soninke), Babacar Diouf, journaliste et anthropologue, Babacar Fall, anthropologue, Mahamet Timéra, sociologue.
Les jeunes filles d’origine africaine en france: Parcours scolaires, travail ...


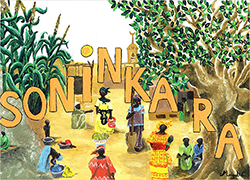
 Dans les années 90, on assiste au retour au Sénégal de travailleurs immigrés retraités. Cette dynamique nouvelle pour les migrations sahéliennes mais plus anciennes pour celles d’Afrique du Nord annonce une forme spécifique de retours correspondant à la fin d’une carrière laborieuse en exil, vécue pour beaucoup dans la solitude familiale et plus précisément conjugale et filiale. Parmi ces retours, ceux des travailleurs immigrés sénégalais ayant acquis la nationalité française au cours de leur séjour en France ont, par les questions qu’ils soulevaient attiré l’attention des autorités consulaires françaises au Sénégal et quelques département du Ministère des Affaires Etrangères en particulier le bureau des Français de l’Etranger.
Dans les années 90, on assiste au retour au Sénégal de travailleurs immigrés retraités. Cette dynamique nouvelle pour les migrations sahéliennes mais plus anciennes pour celles d’Afrique du Nord annonce une forme spécifique de retours correspondant à la fin d’une carrière laborieuse en exil, vécue pour beaucoup dans la solitude familiale et plus précisément conjugale et filiale. Parmi ces retours, ceux des travailleurs immigrés sénégalais ayant acquis la nationalité française au cours de leur séjour en France ont, par les questions qu’ils soulevaient attiré l’attention des autorités consulaires françaises au Sénégal et quelques département du Ministère des Affaires Etrangères en particulier le bureau des Français de l’Etranger. Les foyers de travailleurs immigrés ont été conçus il y a 40 ans comme des lieux d’hébergement provisoire, avec un confort minimum, sans intimité ni droit à la vie privée, pour un maximum de travailleurs y subissant un fort contrôle social et politique. Ils ont été conçus comme des lieux de relégation. Aujourd’hui, ils sont toujours là et connaissent une situation très difficile : mauvaise gestion et délabrement pour certains, entretien inexistant et hausse incessante des loyers pour beaucoup, attente de relogement depuis quinze ou vingt ans pour d’autres. Face à la politique très en deçà des besoins et en général hostile aux foyers suivie par les gouvernements successifs en matière de logement social, face aux politiques anti-immigrés très dures de l’Etat Chirac / Sarkosy, les résidents se sentent plus que jamais menacés et en situation de relégation.
Les foyers de travailleurs immigrés ont été conçus il y a 40 ans comme des lieux d’hébergement provisoire, avec un confort minimum, sans intimité ni droit à la vie privée, pour un maximum de travailleurs y subissant un fort contrôle social et politique. Ils ont été conçus comme des lieux de relégation. Aujourd’hui, ils sont toujours là et connaissent une situation très difficile : mauvaise gestion et délabrement pour certains, entretien inexistant et hausse incessante des loyers pour beaucoup, attente de relogement depuis quinze ou vingt ans pour d’autres. Face à la politique très en deçà des besoins et en général hostile aux foyers suivie par les gouvernements successifs en matière de logement social, face aux politiques anti-immigrés très dures de l’Etat Chirac / Sarkosy, les résidents se sentent plus que jamais menacés et en situation de relégation. 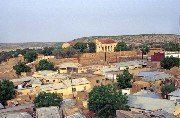 Le changement social est au cœur de cet ouvrage. D'abord en raison de son sujet, qui traite de trois processus imbriqués de transformations : 1) les transformations des villages maliens engendrant les départs en migration vers la France et la progressive dépendance de ces villages envers les migrations ; 2) les transformations internes aux migrations elles‑mêmes des années 1970 à nos jours ; 3) les transformations induites depuis les années 80 au sein des villages par l'action de migrants investis dans le "développement", enfin.
Le changement social est au cœur de cet ouvrage. D'abord en raison de son sujet, qui traite de trois processus imbriqués de transformations : 1) les transformations des villages maliens engendrant les départs en migration vers la France et la progressive dépendance de ces villages envers les migrations ; 2) les transformations internes aux migrations elles‑mêmes des années 1970 à nos jours ; 3) les transformations induites depuis les années 80 au sein des villages par l'action de migrants investis dans le "développement", enfin. TOUT au long du printemps et de l’été 1996, des immigrés de l’Afrique sahélienne, plus particulièrement du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée et du Sénégal, ont fait l’actualité, révélant au grand jour la situation des « sans-papiers » . On serait tenté de s’étonner qu’un phénomène aussi banal ait mobilisé les forces de l’ordre, les médias et l’opinion pendant des mois. En effet, que représentent 300 Africains dans les flux migratoires de la France, sinon un épiphénomène ?
TOUT au long du printemps et de l’été 1996, des immigrés de l’Afrique sahélienne, plus particulièrement du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée et du Sénégal, ont fait l’actualité, révélant au grand jour la situation des « sans-papiers » . On serait tenté de s’étonner qu’un phénomène aussi banal ait mobilisé les forces de l’ordre, les médias et l’opinion pendant des mois. En effet, que représentent 300 Africains dans les flux migratoires de la France, sinon un épiphénomène ?