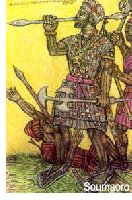L’exil de Djata :
L’exil de Djata :
Soundjata était appelé par des noms multiples : Maghan Konaté (son vrai nom) Diata, Sogolon Diata devenu Soundjata, Simbo, Naré Maghan Mandé nka, Lawali Simbo, Mari Diata, Kirikiya Maghan Konaté, l’enfant du buffle, Sogo-Sogo Simbo (chasseur qui ne revient jamais bredouille, qui tue gibier sur gibier, sogo wo sogo).
Contrairement à la plupart des mansa, Simbo n’a pas abandonné sa patrie pour échapper à la domination des Sosso et à la guerre de Soumangourou qui ravageait le Mandé. C’est son père Farakoro Maghan Kégnin lui-même qui lui avait conseillé de quitter le pays : « Va lion d’ici et ne revient pas avant sept ans, sinon les hommes parviendront à ployer le destin et l’empêcher de s’accomplir. Or Dieu t’a fait venir au monde pour être roi, et le plus puissant de la terre ». Sa mère, de son côté, l’incitait toujours à partir : Sigui tè na ko min gna, tama lé no ban ». « Si la cohabitation ne peut empêcher les tensions et mésententes entre frères consanguins (fadengna dialan), seul l’exil (nianimabori) peut les éteindre ».


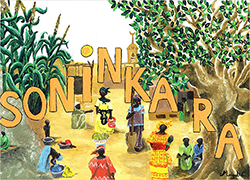
 Conduire des recherches sur sa propre culture offre des avantages certains, cela va sans dire. Cependant, l'entreprise comporte aussi bien des inconvénients. Ces difficultés sont souvent tues, et c'est précisément pourquoi j'en traiterai essentiellement. En effet, un chercheur du cru serait-il plus qualifié pour étudier sa propre culture qu'un observateur étranger ? Ainsi peut-on résumer le débat portant sur le statut du chercheur par rapport à son « terrain » — c'est d'ailleurs plutôt d'un « dialogue de sourds » qu'il s'agit, animé d'abord par les tenants de l'ethnologie classique, ensuite par les enfants des pays et peuples observés, les uns et les autres se prétendant respectivement les mieux placés pour mener des recherches1. Comment le chercheur soninke que je suis peut-il répondre aux divers protagonistes ?
Conduire des recherches sur sa propre culture offre des avantages certains, cela va sans dire. Cependant, l'entreprise comporte aussi bien des inconvénients. Ces difficultés sont souvent tues, et c'est précisément pourquoi j'en traiterai essentiellement. En effet, un chercheur du cru serait-il plus qualifié pour étudier sa propre culture qu'un observateur étranger ? Ainsi peut-on résumer le débat portant sur le statut du chercheur par rapport à son « terrain » — c'est d'ailleurs plutôt d'un « dialogue de sourds » qu'il s'agit, animé d'abord par les tenants de l'ethnologie classique, ensuite par les enfants des pays et peuples observés, les uns et les autres se prétendant respectivement les mieux placés pour mener des recherches1. Comment le chercheur soninke que je suis peut-il répondre aux divers protagonistes ? Le pays soninké a fait l'objet, ces dernières années, de nombreux travaux en rapport avec des questions d'actualité, comme l'émigration en France ou la crise de l'agriculture sahélienne. Le livre de M. Diawara en revanche, traite de l'histoire précoloniale d'une région du Mali encore peu connue, le Kingi ou royaume de Jaara d'après le nom de sa capitale. Par la période concernée, on peut rapprocher cette étude de celle qu'a récemment publiée A. Bathily sur l'État soninké du Gajaaga1. Mais ici, l'histoire du Kingi apparaît surtout à travers ses sources, puisqu'il s'agit d'une analyse des différents types de traditions orales historiques, de leurs fonctions socio-politiques et de leur mode de transmission.
Le pays soninké a fait l'objet, ces dernières années, de nombreux travaux en rapport avec des questions d'actualité, comme l'émigration en France ou la crise de l'agriculture sahélienne. Le livre de M. Diawara en revanche, traite de l'histoire précoloniale d'une région du Mali encore peu connue, le Kingi ou royaume de Jaara d'après le nom de sa capitale. Par la période concernée, on peut rapprocher cette étude de celle qu'a récemment publiée A. Bathily sur l'État soninké du Gajaaga1. Mais ici, l'histoire du Kingi apparaît surtout à travers ses sources, puisqu'il s'agit d'une analyse des différents types de traditions orales historiques, de leurs fonctions socio-politiques et de leur mode de transmission.