L'armée française est omniprésente en Afrique : Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Congo, à Djibouti, à Madagascar, etc., j'en passe.
Mais que fait toujours l'armée française en Afrique ?
Êtes-vous pour qu'elle reste ou qu'elle parte de l'Afrique ?
Quel est son vrai rôle dans les conflits comme le conflit ivoirien?
Quel a été son rôle avant et après le généocide rouwandais?
L'article suivant de http://www.lefaso.net/article.php3?i...&id_rubrique=7 montre comment les opérations militaires de l'armée française dans le monde et en Afrique sont d'abord politiques .
Opérations militaires françaises : Des missions parfois très politiques
mardi 16 janvier 2007.
Outil de la diplomatie, les opérations militaires de la France servent aussi à marquer les ambitions de Paris sur la scène internationale. C’est notamment le cas en Afrique. Par sa présence à l’étranger, l’armée française est-elIe au service de la diplomatie ?
Tout au long du récent conflit libanais, la France a défendu à l’Onu le déploiement d’une force multinationale, se déclarant prête à diriger cette Finul "renforcée". Début septembre, 900 hommes du 1er bataillon d’Orléans débarquaient à Beyrouth, représentant l’avant-garde des deux bataillons - 1 600 soldats - que Paris a décidé d’envoyer au Liban dans le cadre des Nations unies. Certes, la France ne prétend pas résoudre seule la crise entre Israël et le Hezbollah, mais en stationnant des soldats au pays du Cèdre, elle affirme sa volonté de compter dans les affaires du Moyen-Orient.
A chaque crise, Paris déclare qu’elle est prête à prendre ses responsabilités en participant à l’envoi d’une force de maintien de la paix, ou au contraire qu’elle n’entend pas s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays. Ainsi la France a participé à la première guerre du Golfe en 1991, mais a refusé de s’engager aux côtés des Etats-Unis dans le conflit irakien en 2003. Alors qu’elle est présente en Afghanistan, tant pour sécuriser le pays que pour lutter contre les talibans. La présence de troupes à l’étranger représente donc un engagement diplomatique de Paris. Le singulier saupoudrage des troupes françaises en Opex (opérations extérieures) l’illustre : un seul soldat au Liberia et en Ethiopie par exemple, 3 en Géorgie, 15 en Egypte dans le désert du Sinaï, 42 en Haïti, mais 1100 au Tchad, 2 050 au Kosovo, 3 000 à Djibouti et 3 800 en Côte d’Ivoire.
Pour certains, il s’agit là de vanité, de la part d’une moyenne puissance qui a tendance à estimer qu’aucune crise ne lui est étrangère. Pour d’autres c’est une preuve de responsabilité d’un pays membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire qui a conservé de vastes zones d’influence dans le monde. Reste que le sujet est sensible. Bruno Tertrais, de la Fondation pour la Recherche Stratégique, signale que "les opérations militaires de la France sont nombreuses, mais ne font jamais l’objet d’un débat au Parlement.
Comme la politique étrangère. Or les motifs de ces interventions ne sont pas toujours clairs, leurs résultats souvent mitigés, les hypothèses de sortie de crise improbables". Les spécialistes estiment notamment que, si l’armée française se déploie rapidement, elle maîtrise moins la sortie de crise, c’est-à-dire le moment où il faut quitter un pays pour éviter l’enlisement. Plus une présence militaire se prolonge, plus les retombées politiques positives s’amenuisent.
Ses opérations militaires sont-elIes un moyen pour la France de s’affirmer face aux Etats-Unis ?
La puissance de l’armée américaine est sans commune mesure avec celle de l’armée française. De même, les relations entre Paris et Washington sont meilleures aujourd’hui qu’elles ne l’étaient au début du conflit irakien. Néanmoins, la France insiste toujours sur l’idée d’un monde multipolaire et soupçonne les Etats-Unis de vouloir utiliser l’Otan à des fins personnelles, notamment dans la lutte contre le terrorisme.
Cette position oblige Paris à davantage projeter ses troupes à l’étranger. C’est aussi pourquoi les autorités françaises encouragent tant la construction de l’Europe de la défense, "meilleur moyen de consolider l’Union et seul grand projet depuis l ’Euro" pour reprendre les termes d’un diplomate. En toute logique, les troupes françaises se doivent de participer à chaque mission militaire de l’UE. C’est aujourd’hui le cas en ROC, en Bosnie, au Monténégro, au Soudan et en Palestine.
Quelle est la spécificité de la présence militaire française en Afrique ?
Sur les 36 849 soldats français déployés en-dehors des frontières, 11 481 sont basés en Afrique, dans le cadre des Nations unies (Sahara occidental, Côte d’Ivoire et ROC), de l’Union européenne (Soudan et RDC), d’Opex menées par la France seule (Tchad, Cameroun, golfe de Guinée, Togo, République centrafricaine et Côte d’Ivoire) ou de ce qu’on appelle les forces de présence (Sénégal, Gabon et Djibouti). Si on soustrait les 16 570 militaires stationnés dans les DOM-TOM, cela signifie que la moitié des troupes françaises à l’étranger se trouve en Afrique. Impossible de ne pas y voir ce que d’aucuns appellent le lien traditionnel entre la France et ses anciennes colonies.
Jean Piel (MFI)
En Afrique : l’européanisation des interventions françaises
Les forces de présence constituent une spécificité africaine. Elles sont stationnées dans trois pays, en-dehors de tout risque conflictuel, dans le cadre d’accords de défense spécifiques et peuvent intervenir partout en Afrique en cas de crise. Si cette présence tient historiquement à des "amicales pressions" de Paris, aucun gouvernement africain n’a jamais demandé leur départ, et le rapport des autorités locales avec ces bases est ambigu : source de stabilité politique et bouc¬émissaire commode en cas de troubles.
En outre, la distinction entre les trois bases permanentes du Sénégal, du Gabon et de Djibouti d’une part, et les Opex du Tchad et de Côte d’Ivoire d’autre part, reste théorique. Hormis deux interruptions, la France est en effet présente militairement au Tchad depuis 1960, et la menace d’une intrusion libyenne qui avait justifié l’opération Epervier en 1986 est depuis longtemps oubliée.
La France ne tient cependant plus à apparaître en première ligne en Afrique, par crainte de se voir accusée de tous les maux, avec les risques que cela représente pour ses ressortissants. C’est pourquoi elle cherche à européaniser sa présence dans la région.
Ainsi, à l’origine franco-africain, Recamp (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) est de plus en plus un programme européen visant à entraîner et équiper des bataillons du continent à la gestion des conflits, en partenariat avec l’Union africaine. De même, l’actuelle opération Benga, qui vise à sécuriser les élections en ROC, est-elle dirigée par l’Allemagne, et la France n’a fourni que le tiers des troupes.
En 2003, l’Union européenne avait déjà conduit dans le pays l’opération Artémis, mais Paris en avait assuré 75 % du contingent et 90 % des coûts. Cette européanisation n’est pas pour l’instant synonyme d’une diminution du nombre de soldats français en Afrique, ni d’une remise en cause des accords militaires bilatéraux conclus entre Paris et plusieurs capitales. Mais à terme, elle pourrait signifier une réorganisation du déploiement français en Afrique.
J.P.
Le Pays
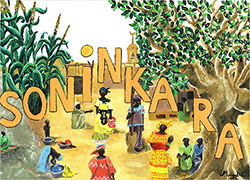
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
Threaded View
- 16/01/2007, 13h31 #1
 Que pensez-vous de la présence de l'armée française en Afrique ?
Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !
Que pensez-vous de la présence de l'armée française en Afrique ?
Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !
http://www.waounde.com

Discussions similaires
-
Khadafi: Armée africaine pour défendre l'Afrique contre le Colonialisme
By Fodyé Cissé in forum PolitiqueRéponses: 21Dernier message: 02/03/2011, 14h08 -
Sarkozy veut réduire la présence militaire française en Afrique
By khaniaganké in forum FranceRéponses: 1Dernier message: 29/02/2008, 10h24 -
Que pensez-vous de l’idée de la création des Etats-Unis d’Afrique ?
By Cheikhna Mouhamed WAGUE in forum Actualités, Coupures de PresseRéponses: 31Dernier message: 03/02/2008, 16h10 -
Elle Est Francaise........mais A Failli être Expulsee En Afrique !!
By Badem in forum Actualités, Coupures de PresseRéponses: 29Dernier message: 03/12/2007, 18h22 -
avez vous lu le livre " LA GRANDE MUTATION", quand pensez-vous?
By Diana Soumaré in forum Littérature, CinémaRéponses: 6Dernier message: 01/09/2006, 22h05


 LinkBack URL
LinkBack URL À propos de LinkBacks
À propos de LinkBacks






 Réponse avec citation
Réponse avec citation